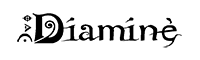Ce n’est pas par la colère, mais par le rire que l’on tue.
En avant, tuons l’esprit de lourdeur !
J’ai appris à marcher : depuis lors, je me laisse courir.
J’ai appris à voler, depuis lors je ne veux pas être poussé pour changer de place.
Maintenant je suis léger, maintenant je vole,
maintenant je me vois au-dessous de moi,
maintenant un dieu danse en moi.«
Friedriech NIETZSCHE – Ainsi Parlait Zarathoustra
Du lire et de l’Écrire
Le phénomène de la tarentelle, par-delà l’approche moderniste de son esthétique musicale, de ses formes rythmiques ou des danses qui la caractérisent, renvoie historiquement et anthropologiquement à une pratique millénaire de ritualité cathartique, se rapportant dans les sociétés rurales du sud méridional européen à la pharmacopée d’une « guérison par les sons« , d’une « musique qui guérit« , caractéristique des cultures régnantes de la Grèce Antique.
La musique, pratique magique et curative, met ici en œuvre son pouvoir rythmique hypnotique, la variabilité des intensités sonores, le pouvoir pathétique des sons sur les émotions, les envolées lyriques, l’alternance entre tensions et relâchements successifs porteuse de dissociation, au service d’une rédemption (caqarsiV – katharsis) du sujet possédé.
Mais quelle est la nature de ce mal que l’on identifie sous le symbole de la taranta ?
Dans les temps anciens, lorsqu’une personne était « piquée par l’araignée », il s’agissait, l’ensemble de la communauté locale cessant toute activité, de traiter la taranta, de soigner le mal identifié par une mobilisation des énergies collectives autour d’un rituel qui pouvait durer des jours, parfois des semaines entières.
Ce rituel laïc (du grec laikoV [laikos], qui se rapporte au peuple, en opposition au monde des clercs, au principe hiérarchique – ieros/arcos [hieros/archos], « commandement du sacré« ) ne relève pas d’une liturgie intangible, d’une téléologie de la damnation ou du péché originel, mais se vit avant tout comme un théâtre du quotidien dont la dimension corporelle révèle le drame de la condition humaine.
Drame car, selon l’épistémologie archaïque, la vie humaine, loin d’être une épopée héroïque, met en scène deux grandes forces contradictoires que sont la vie et la mort.
« La tragédie grecque, écrit Fernand Dumont, repose sur une tension entre des normes, normes du destin et normes de l’homme. Drame de l’humanité plutôt que drame personnel : conflit des puissances plutôt que conflit de raisons. […]. Aussi l’histoire est-elle tension entre les forces du destin et la délibération humaine« .[1] Ainsi, précise Hans Urs Von Balthasar[2] : « en vivant son incarnation, l’homme, être cosmique, se découvre destinée, communauté, histoire, pérennité. Il est l’aboutissement d’une certaine évolution de la vie qui se personnalise dans l’homme vivant. C’est en quelque sorte un cheminement de la vie vers la conquête de son plein épanouissement.«
Mais ce plein épanouissement de l’homme originel selon l’ordre d’une idéale liberté rencontre en chaque existence particulière oppositions, obstacles et contraintes pouvant lui venir à la fois de sa nature propre, de son environnement comme d’une volonté divine ou de l’ordre social d’un État…
Esclavage, servage, salariat, écrit Alèssi Dell’Umbria, brisent l’unité originelle entre l’âme et le corps, constitutive de l’humain : contraintes, soumissions, consentements opèrent dans le sujet comme une « évaporation de l’âme« . Ce à quoi se rapporte Hegel dans son Encyclopédie des Sciences Philosophiques : « lorsque l’âme s’est enfuie du corps, les puissances élémentaires de l’objectivité commencent à jouer. Ces puissances sont, pour ainsi dire, prêtes à bondir pour commencer leur processus dans le corps organique, et la vie est le constant combat contre cela. »
Les pratiques traditionnelles de la tarentelle, à l’instar des antiques cérémonies dionysiaques, repose sur un farmakon [pharmakòn], un poison, une possession d’origine tellurique qu’il s’agit d’abolir par le moyen de cérémonies rituelles usant de la Mania et de la transe. Relevant de cette esthétique dionysiaque, ces dispositifs sollicitent une énergie dévastatrice, capable de renverser la cité, « réduisant à néant toute structure de domination pour libérer l’humain« [3].
La Mania, démence furieuse, délire épileptique ou irritabilité exacerbée, s’y traduit comme la réaction à une condition affligeante générant le poison qu’il s’agit de curer. En ce sens, elle s’empare essentiellement des exclus, des opprimés ou de ceux dont la vitalité se voit contrariée par leur condition existentielle. Sur un plan clinique, la taranta se manifeste par des pertes de connaissance, un état catatonique ou encore une fébrilité incontrôlable, à caractère névrotique…
« La tarantata est un corps dont l’âme s’est échappée et demande à revenir« [4] et le tarantisme, renouant le temps d’une danse le lien entre la psukh (psyché) et le soma (soma), vient suspendre les effets de ces névroses quotidiennes, pour un retour à l’unité primordiale : corps-esprit, homme-monde.
Le support opératoire de cette catharsis collective est une musique abrupte, participative, portée par les scansions hypnotiques du cycle des percussions et les envolées lyriques d’un chant évoquant le mal et la guérison. Une musique qui s’adresse directement au corps et non à l’esprit de l’opprimé qu’elle prétend libérer, « projette le rythme biologique dans un temps musical, tandis que la danse inscrit celui de l’individu dans l’espace.[5]«
Dans un premier temps, l’on y recherche le déséquilibre, la chute ou le balancement originel du berceau. Puis, le rythme cyclique prenant appui sur les battements du cœur et la respiration des participants, la scansion s’ancre dans la substance biologique pour s’envoler vers une furie maniaque, bousculer les émotions, renverser la complexion corporelle pathogène. L’adepte, entrant en transe, se dépersonnalise et devient lui-même pharmakon, à la fois poison et remède, dans une frénésie dansée lui faisant déployer des capacités énergiques « surhumaines », extra-quotidiennes, à la poursuite d’un surpassement des oppositions morbides qui auront généré le syndrome.
S’abandonnant à la mania qui disloque son état antérieur, le possédé expulse ainsi le venin, piétine l’araignée, et ouvre l’espace à la réintégration de l’âme dans le corps. La contradiction levée, l’harmonie corps-esprit, homme-monde, s’en trouve rétablie ; le sujet redevient maître du malaise qui l’opprime, reprend pour un temps pouvoir et hauteur sur le drame existentiel qui l’avait fait vaciller. S’opère alors la rédemption, le retour à l’intégrité originelle, l’unité primordiale pour un temps perdues sous le poids des coercitions.
Cette voie particulière de la cure exige du sujet, pour atteindre son but, une participation active, une volonté de guérir et un profond effort de surpassement de soi. C’est là une approche de la guérison radicalement différente de celle des sociétés modernes : loin d’installer le malade dans un état de passivité ou la prise en charge du mal par une opaque technostructure de protocoles savants, la « thérapie par les sons » mobilise les techniques musicales comme un medium pour agir sur le pharmakon (poison et remède), offrir au possédé la vibration et le rebond nécessaires à la rédemption de son mal.
Par les moyens du rythme et de la mélopée, avec l’aide de la communauté qui l’entoure, le musicien-médecin parvient à en activer les effets dans le corps de la tarantata.
Le reste est affaire de furie, de mania dévastatrice, dont seul le sujet détient au fond de lui les clefs, propres à vaincre les puissances hostiles de l’objectivité, les atteintes à l’intégrité de sa personne.